Brisset est l’un de ceux qui a poussé la recherche de l’origine humaine dans le langage vers ses plus profonds paroxysmes linguistiques. Ainsi, lorsque l’on considère Les origines humaines (Jean-Pierre Brisset, Les origines humaines, ed. Rroz), immédiatement, il nous prend à partie, dans le parti pris de la langue, indiquant que son horizon n’est autre que de donner une science permettant de sonder l’émergence de l’homme-animal ou de l’homme esprit. C’est par la recherche des archi-traces dans le langage qu’il sonde la composition des mots, qu’il les détache de ce que l’on croit connaître et que l’on découvre une autre histoire que celle de notre origine :
Les cris de la grenouille sont l’origine du langage humain. Lorsqu’elles chantent en réunion, c’est de loin un brouhaha de foule humaine. Leur langage actuel ne peut d’ailleurs que donner une idée imparfaite de ce qu’il était, alors que l’esprit qui anime toute l’humanité se mouvait sur la surface des eaux et était concentré sur ces animaux (p. 123).
Certes, comme le note à juste titre Christian Prigent dans sa préface, c’est dans l’arbitraire des signes et des analogies, dans le recours hyperbolique au calembour qui est une méthode, une ressource savante, l’outil philologique par excellence, (…) la divine puissance génético-linguistique (p. 31), que Brisset accomplit ce retour. Toutefois, s’installant dans l’ordre généalogique, il exprime là en quel sens le jeu des mots, le jeu des associations se construit, parce qu’un vide s’est installé dans la connaissance, celui de l’énigme de l’architrace. Et c’est sans doute ici l’un des secrets de la poïésie du langage, que les agencements se nouent autour d’un trou, du creux de son origine toujours absente et désirée, comme vérité ontologique de l’homme. Dans ses différentes compositions verbivisuelles, Julien Blaine semble n’avoir de cesse de poursuivre cette question de la trace.
Trace de quoi ? Trace de monde, des choses, de leur inscription dans le tissu du monde, trace de la formulation des mots, formant strates, renvois, jonctions, échos, parfois distorsions. Trace d’une origine de la langue mais pas en dehors d’un texte, ou d’un livre, mais dans le livre du monde, dans sa chair matérielle. La trace pour Julien Blaine n’est pas ainsi d’abord et avant tout dans l’ordre linguistique mais, au sens aristotélicien, dans la poiésis fondamentale de la nature et de l’inscription humaine au cœur de celle-ci. Il n’est pas alors étonnant que peu à peu ses déambulations, tout au long du monde et des langages humains, l’aient placé dans l’horizon d’une origine de la langue, de la recherche d’une archi-trace de sa survenue : ces cahiers sont le reflet, les textes et les images, les signes, les études, les recherches d’un travail que j’ai commencé il y a longtemps sur l’écriture originelle. Les Cahiers de la 5e feuille, publiés par Al Dante, prennent ainsi leur consistance dans la perspective d’une mise à nu de la langue et de son inscription. Mise à nu pour qu’à même les agglomérats de signes vienne se signer sa proto-empreinte, sa source. C’est à partir de la forme de la feuille : œil, plume, surface, que s’établissent Les cahiers de la 5ème feuille : trouver à même les choses, le punctum caelum autour duquel la langue s’est faite. La feuille se présentant comme ce point aveugle, ce à partir de quoi et pour quoi les mots se marquent.
Toutefois, alors que Ponge par exemple rejette toutes les choses dans une dichotomie totale des mots et des choses comme il l’indique dans La rage de l’expression, là pas du tout : empiètement, tissage, composition, entrelacs matériel. Blaine se pose au lieu de porosité entre les signes du langage et les signes du monde. Et cela comme un seul et unique lieu. Pour Ponge, Les choses et les poèmes sont inconciliables (p. 10), toute chose ne pouvant être exposée que dans l’enchevêtrement même du logos, car face au monde, le poète doit les refaire dans le logos à partir des matériaux du logos, c’est-à-dire de la parole (p. 51). Au contraire pour Blaine, il semblerait que le logos ne soit qu’une strate particulière de signes, strate parmi d’autres strates. C’est pourquoi rencontrant la feuille, ce n’est pas un mot qu’il tente de cerner, ce n’est pas selon une scientificité de son épuisement définitionnel logologique ou seulement phonologique (ce qui serait le cas si on réduisait ce poète à n’être qu’un poète sonore, malentendu trop courant malheureusement), mais il suit, poursuit, traque et expose son motif, son empreinte à partir d’un autre tissu, celui des œuvres humaines et des œuvres naturelles entremêlées.
Ces Cahiers de la 5ème feuille n°3 se présentent ainsi d’emblée comme les traces d’une enquête. Ils rassemblent non des preuves mais des témoignages. Comme pour Brisset, ou Ponge, la scientificité poiétique est celle de la généalogie, de la structuration singulière d’une descendance à la mesure d’une interprétation, et non pas l’élaboration objective et neutralisante d’une volonté de vérité. Ainsi, cela commence par un trajet-témoignage par Medelin, et se boucle autour d’autres témoignages : lettres d’amis qui lui sont écrites et qui expriment cette origine ou obsession de la feuille/vulve. Mais si la feuille est bien le signe qui fait un clin d’œil, qui est bouche horizontale (lèvre/œil) et bouche verticale (vulve), c’est qu’elle n’est pas que surface, mais qu’elle est fondamentalement aussi profondeur, appel, lieu retiré de l’inscription. Car écrire exige que le lieu qui s’ouvre à l’écriture (la feuille) soit aussi retrait, afin qu’il permette l’inscription. Or, la feuille, ainsi allongée, est corrélativement aussi pour l’homme, non pas seulement œil, mais vulve gonflée, à la fente qui vient découper en deux les deux lobes de chair. Courbet ne s’y serait pas trompé. Masson non plus recouvrant cette Origine du monde d’un paysage.
Vulve mystérieuse, origine du monde, la vulve a la forme de la feuille, elle en est l’incarnation, l’incantation, elle est la trace concrète de sa profondeur. Et pour cela appelle l’œil. Et pour cela appelle le stylet de l’écriture, l’amorce phallique de la pénétration de ses profondeurs, comme on peut le voir avec les photographies pp. 56–60. Ces Cahiers de la 5ème feuille déterminent donc le lieu où langages et choses se donnent en tant qu’étant de même nature. Il y a donc des niveaux ontologiques à voir et à agencer. Certes, il y a la scène de notre langage (et de ses déclinaisons), mais cette scène est originellement issue d’une scène moins perceptible, qui d’aucune manière n’est en-deçà, ou au-delà, mais bien plus à côté de ce que nous avons coutume d’observer. Cette scène qui est toujours déjà là, qui s’efface pour que les signes se dispensent, est celle du monde. C’est pour cette raison, que selon Blaine, s’il y a bien l’écriture de la main (signes et pictogrammes qu’il utilise souvent depuis quelques années, aussi bien dans ses textes ou préface) il y a aussi les signes d’autres écritures. Celles des branches, des coquillages, des photographies, des arbres pour exemple : Ecriture et ecfruiture.
Or pour témoigner de cela, il est évident, que Blaine poursuit l’horizon ouvert aussi bien par les premières expériences de spatialisation des futuristes que les approches concrètes de la langue chose des concrétistes. Même s’il en poursuit et en rompt certains paradigmes. En effet l’écriture verbale ou mathématique, au lieu justement de postuler un topos autonome, se laisse investir, à foison, par les autres signes (photographies, empreintes, photocopies… etc.) Il ne s’agit aucunement là d’une illustration, mais d’une polymatérialité de l’écriture. Faire surgir l’archi-trace pour Blaine, c’est alors en revenir à un archaïsmes des signes. A propos De la viande Des muqueuses Des fossiles et par conséquent De la photographie Ou de la photogravure (pp. 54-sq) Néanmoins, loin de convier à un retour aux origines, qui appellerait à rompre avec notre époque et ses potentialités techniques, comme certains lyriques peuvent l’énoncer, Blaine se lie d’autant plus à la technologie. Nous retrouvons là l’une des composantes majeures des recherches littéraires au XXe siècle. Loin de rejeter l’apport de la prothèse technique, comme illégitime, altération, falsification du travail de scripturalité, tout à l’inverse seule la technique peut ouvrir certaines des possibilités de l’écriture. A chaque impression correspond une forme. 1/ la lettre gravée 2/ tracée 3/écrite 4/ imprimée. (…) Pour l’offset et le papier humide ce serait par le calligramme et la poésie dite visuelle ou visive (la poésie concrète appartient encore à la typographie). Hui pour les programmes informatiques, j’avance avec ça (p. 21). Nous avons enfin avec ces nouvelles machines, trouvé les résidus qui mêlent sans distinction l’image et le texte. Ce résidu n’est ni vers ni icône il est verssicône (p. 47).
Rechercher l’écriture originaire n’implique pas alors de renoncer aux techniques. Ces dernières étant aussi inscrites dans la ligne généalogique de cette origine, en tant qu’elles sont les sites possibles de son actualisation en tant que trace en retrait dans les traces qui nous sont présentées. L’origine n’est pas ailleurs que dans la trace qui se forme, elle en est l’épicentre en creux, le recto nécessaire à toute donation de signes. Déjà, les 13427 poèmes métaphysiques exprimaient cela. La métaphysique n’est pas un au-delà, arrière-monde d’écriture, mais c’est l’ouverture à une autre logique que celle de la physique de la science. Un autre cosmos, avec d’autres lignes de cohérence. Méta, comme en-deçà de la séparation dont témoigne Foucault, dans Les mots et les choses, entre le langage et le site du monde. Mais cet en-deçà n’est pas ailleurs, il est toujours déjà présent. A l’œuvre, mais voilé par la surdétermination du regard. Comme était voilé pour celui qui ne savait pas voir les réseaux de renvoi entre les choses et les mots. Ainsi, Blaine ne parle pas du monde, il ne vient pas le représenter, mais il se laisse en être la présentification, il recueille dans le livre ses signes, ses traces, celles insignes de cette écriture originelle toujours dérobée. C’est pour cela qu’il y a toujours de l’effacement dans l’écriture. L’effacement commence par celui de la feuille. Et dès lors écrire demande de faire ressurgir l’effacé de toute écriture, le livre en tant que lieu même de l’événement du signe, son impression, constitutif de l’effacement de l’archi-trace.
Le livre qui nous fait face — celui de Blaine — n’est plus ainsi neutralisé par le sens, mais il est volume où doivent se sédimenter les traces qui surgissent sur un autre livre, celui du monde. Celui qui écrit n’est plus sujet, mais il est membrane qui est impactée, modifiée, modelée par le monde, par ses déplacements en ses flux et courants. Tandis que je bouge ma pensée se modifie, se démode, se modèle L’autre qui bouge me fait remuer et mon jugement s’adapte (p. 11). L’écriture se découvre être les traces singulières de leur impact sur un être. Sur sa peau. “la peau c’est le parchemin” et comme il l’écrit : “je livre le livre c’est ma peau” (p. 41). Cette inscription est celle singulière, d’une trajectoire à la fois dans l’espace et dans le temps. La poésie de Blaine se dresse dans l’immanence d’une existence et de ses déambulations. Elle est déambulatoire, sans cesse relancée par ce qu’elle rencontre en tant que signes. Et c’est là toute la difficulté pour le lecteur d’appréhender ce geste, de comprendre ce qu’il met en jeu, ce qu’il immisce en nous, pouvant très vite — comme bon nombre — être classé comme poésie-bibelot, comme creuset de tout et de n’importe quoi. Or c’est là que l’on passe à côté non seulement de la force de construction du livre, mais en plus à côté justement de cette volonté de poésie totale en horizon de l’archi-trace du langage du monde.
Nous-mêmes devons, à l’inverse, rencontrer ce livre comme signe du monde que nous nous réapproprions. Julien Blaine non seulement sait comment sa peau, par la transmission, va être transformée, mais en plus il invite à cette transformation. Il invite à ce que nous-mêmes nous découvrions notre être-livre, “Livrez-vous / Ce livre est vous” : Que votre maison n’affiche sur ses murs que des pages de livre agrandies : les pages de votre choix celles qui vous ont marqué. Ainsi le texte imprimé (marqué) sur la page du livre vous a marqué (imprimé), vous aussi, et vous êtes devenu, vous aussi, livre, ce livre, l’un de vos livres, ces livres, ce fragment de livre, ces fragments de livre (p. 48).
philippe boisnard
Julien Blaine, Les Cahiers de la 5e feuille — n°3, Al dante, 2003, 23,00 €.

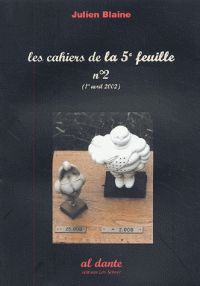
Pingback: Florence Pazzotu, Frères numains (discours aux classes intermédiaires) – Littérature et lecture
Philippe
Je trouve ton texte par hasard.
Oh lala quel lecteur tu es !
Je prépare l’édition complète des 8 volumes…
Nous allons en parler
A toi
J