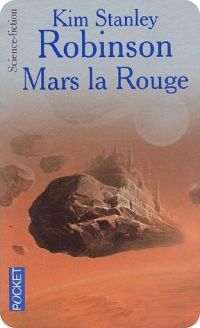 Le Cafouillis à la science sur lit de fiction
Le Cafouillis à la science sur lit de fiction
Pour faire un bon Cafouillis à la noix de SF, comme en faisait notre grand-oncle Kim dans les années 90, il faut se procurer des racines de bonnes idées, un futurologue pur jus du genre scientificus polydisciplinarus, le manuel J’apprends à écrire le tohu-bohu et enfin, une grosse bétonnière pour bien brasser tout ça. Au bout de quelques soirées interminables, le résultat du Cafouillis est garanti – avec des grumeaux.
Kim Stanley Robinson est un grand nom du sous-genre « SF dure ». Cette catégorie, également nommée hard science-fiction pour ne pas en ôter la primeur aux anglophones, ne désigne ni une œuvre de SF pornographique, ni un récit empli de chevelus spécialistes du headbang sur des riffs de Metallica, mais bien un genre de fiction qui a l’ambition d’être scientifiquement plausible. De la science-fiction qui promet de ne pas être fictive. De la science littéraire ; voilà tout un programme. Pourtant, entre une carrière scientifique ou littéraire il faut parfois choisir au risque de voir surgir du papier une créature horrifique, boiteuse et bossue, que le lecteur a bien envie d’achever à coups de pelle, ne serait-ce que par pitié.
Il est vrai que la science-fiction est une littérature qui tend particulièrement à la prospective dans la mesure où son credo initial est d’explorer les chemins que pourraient prendre l’humanité, à l’aune des découvertes scientifiques, tout en projetant ses peurs et ses fantasmes dans un futur plus ou moins proche. C’est pourquoi, réalité scientifique et fiction se rejoignent souvent ; que la seconde anticipe la première ou que la première veuille accomplir la seconde. Aussi, une assise scientifique aux romans de SF est la bienvenue en ce qu’elle assure au lecteur un certain degré de réalisme à une hypothèse romancée, voire peut permettre de le convaincre de la dangerosité de certaines avancées technologiques dans le cas des dystopies.
Désireux de pousser le réalisme scientifique au plus près, Robinson fut l’instigateur d’un courant de SF baptisé par lui-même Real Science Fiction qu’il met en exergue en signant son premier roman, premier né d’une trilogie martienne. S’il reçoit le « prix British Science Fiction » en 1992 et le « prix Nebula du meilleur roman » en 1993, c’est certainement pour les idées intéressantes qu’il y développe.
L’intrigue principale du roman est effectivement attrayante et permet d’imaginer la colonisation d’une planète par un groupe de scientifiques devant œuvrer à sa terraformation. Le sujet est fantastique. Il permet une liberté imaginative totale puisque cet embryon d’humanité à l’ambition démiurgique doit repartir de zéro, sur une planète étrangère et hostile, où tout est à découvrir et à entreprendre. Cette question est d’autant plus passionnante considérant que les revues scientifiques actuelles titrent sur les travaux des scientifiques visant à modifier le climat de la Terre à l’heure du réchauffement planétaire. Or, Robinson avait déjà cette intuition de la terraformation de notre propre planète puisqu’il en évoque brièvement le sujet.
A la question « que se passerait-il si des humains allaient sur Mars pour la terraformer ?», il échafaude le scénario typique d’une colonisation humaine avec son exploitation outrancière par les entreprises ayant financées le projet (et le capitalisme fut), l’envoi en nombre de travailleurs cupides, de forces gouvernementales et d’immigrés rejetés par leur patrie originelle, pour conclure par un soulèvement indépendantiste. Le lecteur ne peut reprocher à Robinson de ne pas innover en la matière car ce schéma est cohérent au regard de sa volonté de réalisme et toutes les colonisations humaines se sont déroulées, peu ou prou, de la même façon dans l’Histoire. Ce qui lui est préjudiciable, c’est qu’il n’assume pas cette reproduction. Il ne l’analyse pas ni ne la commente. Pire, il l’ignore et la fait nier par l’un de ses personnages avant de clore un sujet qu’il donne l’impression de soulever malgré lui, comme si, à un moment de son écriture, il s’était étonné lui-même de cette reproduction coloniale sans vouloir s’y attarder.
Cette maladresse scénaristique dans le déroulé de son intrigue n’est pas isolée. S’y ajoute, par exemple, l’incohérence amenant le débat, au demeurant très intéressant, à propos du dilemme moral : terraformer ou ne pas terraformer ? Mais la question ne devrait pas se poser ; en tout cas, pas au moment où les colons scientifiques ont voyagé des années dans l’espace et se sont déjà installés sur Mars, puisque le but même de leur venue est d’y vivre. Il est donc évident que, pour réaliser ce projet, il sera nécessaire d’adapter cette planète aux besoins humains et que l’édification même d’une cité sous une cloche d’air respirable est déjà une modification du paysage martien.
Pour justifier les errements moraux de son personnage anti-terraformation et en éluder l’incrédibilité, Robinson avance les prétextes peu convaincants de ses mensonges, donnés au comité de sélection dans le but de découvrir Mars, et de son tempérament mélancolique et passionné. L’argumentation est finalement pataude et fait naître le sentiment que l’auteur n’a pas réussi à surmonter cette incohérence, alors qu’il aurait pu le faire adroitement avec une meilleure mise en scène. Enfin, il noie son lecteur sous des pages entières de descriptions scientifiques complexes et détaillées mais il ne décrit pas, ou très peu, des objets que ses protagonistes utilisent tout au long du roman : les marcheurs, les patrouilleurs, les « consoles de poignet »… Si bien que, non seulement nous ne savons pas par quel miracle ils fonctionnent mais, surtout, nous n’en avons qu’une très vague représentation, laquelle pourra varier selon les bribes d’informations que Robinson veut bien nous donner au fil de son récit. Le lecteur pourra ainsi s’imaginer que les patrouilleurs sont des véhicules terrestres à la forme arachnide destinés à un seul pilote, puis des véhicules chenillés gigantesques, pour finir par n’être qu’une sorte de gros camion.
Quant au fil conducteur de la terraformation, il ne tient pas en haleine autant qu’on l’aurait voulu car il est dissout par des flots d’informations scientifiques au lexique hyperspécialisé ayant trait à des domaines aussi variés que la biologie, la physique, la psychologie, l’ethnologie… Le plus pénible est que ces descriptions, parfois étayées par des schémas ou des formules scientifiques, n’ont aucune plus-value. Robinson ne les met pas en perspective et elles n’apportent rien à son récit. Tout au contraire, elles en desservent la lecture tant elles la rendent opaque, lourde et rompent le rythme de l’intrigue. Elles donnent finalement l’impression que Robinson étale ces connaissances pour elles-mêmes… Comme la confiture culturelle bien connue.
Même la description des modes de vies des groupuscules d’étrangers n’échappe pas à cette impression d’étalage et de répétition. On comprend pourtant que Robinson, suivant le modèle de l’immigration américaine, ait imaginé la culture martienne naissante comme un syncrétisme culturel. Qu’il l’ait voulu ou non, son multiculturalisme se fige en salad bowl et chaque ethnie terrienne reste en autarcie dans son coin, au moins pour ce premier tome, ce qui est plutôt décevant et ne justifie pas que le narrateur s’y attarde à ce point.
Tout cela s’ajoute finalement à la lenteur générale, à grand renfort d’énumérations de dizaine d’outils, de couleurs ou de termes géomorphologiques , d’explications professorales, de discussions qui n’ont aucun intérêt pour le lecteur comme pour l’histoire, de descriptions inutiles, d’états d’âmes redondants de personnages, de répétitions détaillées d’événements… Même la révolte finale, qui peut tenir momentanément l’intérêt du lecteur éveillé, est gâchée par l’étirement lassant de scènes sans propos qui n’en finissent pourtant pas. En outre, les intrigues secondaires sont peu nombreuses, ténues et trop souvent mal amenées.
Par exemple, la résolution de l’enquête d’un protagoniste sur les sabotages des installations de terraformation tombe soudainement et avec évidence, sans à-propos qui aurait permis d’aiguiller le personnage autant que le lecteur. Il faudra reconnaître toutefois à Robinson d’avoir mis en avant aussi bien des hommes que des femmes et d’avoir, semble-t-il, eu à cœur de défendre une vision égalitaire des genres, au prix de ce qui pourra apparaître comme un ethnocentrisme arrogant, voire raciste.
En effet, il fait critiquer la civilisation arabo-musulmane par l’un de ses protagonistes, lequel annonce très franchement à ses hôtes qu’il les considère comme des esclavagistes machistes. Là encore, si l’idée de fond est intéressante sur le traitement culturel des femmes et sur l’ethnocentrisme en général (la condition des femmes dans les sociétés occidentales ne pouvant prétendre être exemplaire en matière d’égalité), la mise en forme est vraiment malhabile et superficielle. Bien que celui qui tient ce propos soit volontiers décrit comme colérique et amer, aucun indice narratif ne laisse penser que l’auteur ne pense pas exactement ce qu’il lui fait dire.
D’ailleurs, ses personnages ne sont que succinctement décrits. Ils n’ont que peu de relief et apparaissent inintéressants, lorsqu’ils ne sont pas totalement antipathiques. Ils sont tous égoïstes, ne partagent pas grand chose, hormis des querelles, et leurs histoires sentimentales se résument à de simples échanges pulsionnels ; platitude amoureuse plutôt déconcertante. Enfin, si la folie de certains est justifiée, leur mise en scène ne fait qu’amener des incohérences narratives incompréhensibles.
La pauvreté des protagonistes est en fait à l’image de la pauvreté stylistique et des innombrables maladresses narratives plutôt indignes pour un écrivain ; car s’il y a bien un personnage essentiel à une œuvre, c’est le narrateur. Pour comparaison, à blague identique c’est souvent la seule prouesse oratoire qui fera la distinction entre une bonne et une mauvaise. Le narrateur peut être clairement identifié en tant que personnage, soit parce qu’il s’agit d’un récit à la première personne, soit parce qu’il raconte une histoire en s’adressant directement au lecteur. Ou bien il peut être plus discret et pourtant imprimer profondément sa marque dans la narration, soit parce qu’il décrit les choses avec un style travaillé, soit parce que, en se focalisant sur un protagoniste en particulier, il en extériorise toute sa représentation mentale.
La narration de Robinson est ici identique à la profondeur de ses protagonistes : superficielle. Il nous raconte cette histoire un peu comme il le ferait s’il nous lisait le mode d’emploi d’un déambulateur ; insipidité narrative qui pourra finir d’exacerber complètement un lecteur déjà fort agacé par un fil conducteur embrouillé qui se rompt sans cesse.
La pire des maladresses est sûrement le début de son récit : une prolepse totalement absconse et sans aucun effet d’amorce. Une prolepse, ou flashforward, est un procédé stylistique qui vise à susciter l’intérêt du lecteur en lui donnant un avant-goût d’une fin qu’il lui tarde de découvrir et de comprendre. Pour être efficace, elle doit être brève et ne comporter que des éléments pertinents. Ici, la prolepse est une ouverture, non pas sur la fin, mais sur le milieu de l’intrigue. En outre, elle est longue et installe déjà le récit en invitant le lecteur à découvrir des habitats bien établis sur Mars, tout en expliquant scientifiquement la composition de la « tente ». Le lecteur est ensuite plongé au beau milieu d’un carnaval terrien, sur Mars, qui reste inexpliqué, entre des groupes humains, suisses ou arabes, à propos desquels il ne sait rien, et suit les errements d’un individu apparemment dérangé, qui fait des choses incompréhensibles. Puis le roman débute, rétrospectivement.
Et les enchaînements insolites s’enchaînent ainsi tout au long du récit : la discontinuité de personnages, arbitraire et injustifiée au regard du schéma narratif, des passages soudains rédigés comme des témoignages par on-ne-sait-qui, quelques scènes sordides dont on ne comprend pas bien l’intérêt, l’apparition saugrenue, entre deux parties, d’une histoire mettant en scène un certain Paul Bunyan, un bûcheron du folklore étasunien revisité à la sauce martienne, le mysticisme géophage et orgiaque d’un groupuscule sectaire caché quelque part, une temporalité chaotique et incertaine, des passages creux qui s’éternisent puis des ellipses de plusieurs années…
Enfin, le narrateur oublie souvent de préciser qui est la personne qui prend la parole lorsqu’il rapporte une discussion au style directe. Ce trait s’accentue davantage lorsqu’il relate les rêves de ses protagonistes sans indiquer clairement à son lecteur qu’il s’agit d’un rêve. Mais, de surcroît, il ajoute à ces rêves implicites des dialogues sans aucun signe d’énonciation. A la fin, il est probable que beaucoup de lecteurs n’y comprennent plus rien et aient franchement l’impression que le narrateur se moque d’eux.
Car la lecture repose évidemment sur un contrat tacite avec l’auteur. Le lecteur accepte de se laisser mentalement transporter dans son univers à la condition, toutefois, que le narrateur fasse bien son boulot et qu’il ne l’embrouille pas, particulièrement lorsqu’il s’agit des règles mêmes de l’écriture que sont, par exemple, les signes d’énonciation – à moins qu’il ne s’agisse d’un effet voulu dans un but précis que le lecteur pourra clairement identifier. Dans le cas d’un roman sérieux qui se veut réaliste, il est plutôt malvenu de ne pas respecter ce contrat. Au mieux cela donne l’impression que Robinson ne maîtrise pas l’écriture, au pire qu’il n’a aucun égard pour son lecteur. Si bien que ce dernier aura le sentiment de ne pas savoir où le narrateur veut le mener, ni ce qu’il cherche à lui dire dans tout ce fatras mal agencé.
Finalement, le Cafouillis est à point : un grand tohu-bohu en sa forme et son fond. Dommage, l’idée était intéressante. Mais une bonne idée suffit-elle à faire un bon livre ?
Cela dit, d’autres lecteurs pourront le savourer et apprécier d’être ballotté sans ménagement par un narrateur qui exécute une jongle malhabile avec tous les sujets qui lui tombent sous la main s’ils sont avides de connaître toutes les subtilités du calendrier martien ou d’apprendre l’arabe avec les soufis, de connaître en détail les états d’âmes interminables d’une babouchka aimant et aimée par deux hommes, de suivre l’exposé des arcanes de la bio-ingénierie ou encore d’affronter des péripéties palpitantes rapportées en slow motion.
Après tout, tous les goûts sont dans la lecture.
sophie bonin
Kim Stanley Robinson, Mars la Rouge (Red Mars, 1992), trad. Michel Demuth &tDominique Haas, Pocket, collection « Science-fiction », 2003.
